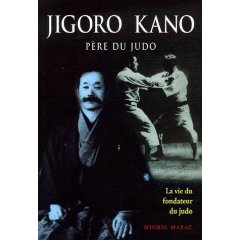 Jigoro Kano, Père du judo. La vie du fondateur du judo
Jigoro Kano, Père du judo. La vie du fondateur du judo
PLAN DE L’OUVRAGE :
Cet ouvrage constitue une tentative de retracer la démarche pédagogique de Jigoro Kano et de son développement dans le cadre du judo.
L’ouvrage est découpé en trois parties : (1) La naissance d’une personnalité - une adolescence où se mêlent tradition et modernisme, et les débuts d’une vocation : enseigner ; (2) La maturité : une synthèse réussie – l’affirmation de ses idées sur la pédagogie, la création du judo : une élaboration lente et réfléchie, et le développement du judo : trois grandes institutions ; (3) L’aboutissement d’une vie – judo, sport et éducation physique idéale, et le judo pour tous.
COMMENTAIRES SUR L’OUVRAGE
Si dans la première partie, l’auteur établit une description des contextes personnel et politique de Jigoro Kano et de son parcours dans l’éducation nationale, les deux parties suivantes nous intéressent plus particulièrement, notamment, du fait de nombreuses traductions de textes de Kano. Elle concerne la pédagogie et le judo. Kano, en 1915, soulignait que « Rien n’est plus remarquable en ce monde que l’enseignement. Les connaissances d’un homme doivent contribuer largement aux autres hommes. Les connaissances d’une génération doivent profiter à cent autres ».
J. Kano insiste sur l’importance de l’utilisation efficace de l’énergie, et de l’entraide et de la prospérité mutuelle. Utiliser efficacement l’énergie permet aux hommes de vivre en société, et de vivre mieux. La confiance réciproque au sein de la société est déterminante, les conditions de l’acquisition de cette confiance étant la capacité, la loyauté et l’assiduité. Il précise, enfin, que l’éducation de l’Homme est à parfaire sans relâche, avec l’idée d’une construction perpétuelle.
Cette contribution à la vie de la société suppose l’apprentissage et le perfectionnement des qualités de chacun. Cela passe, par exemple, par le développement de l’observation, de l’attention, de la réflexion et de la mémoire. Tout un chacun doit également posséder un corps sain et robuste. La solidité du corps s’acquiert, elle n’est pas innée. Il faut donc la cultiver. Cependant, cette recherche doit se faire avec discernement. L’esprit, et d’une manière générale la culture (comme vecteur de transmission des connaissances inter et intra-générationnelle), sont aussi des éléments indispensables. Il ne faut pas non plus négliger les aspects de devoir (par rapport aux autres) et de courage (courage actif = détermination ; courage passif = patience). La phrase clé est de ne jamais perdre de temps. Tout moment peut et doit être utilisé.
Mais la réalisation de ce but est subordonné à deux conditions : savoir évaluer ses propres possibilités et pouvoir compter sur son expérience. Cette expérience manque aux jeunes, d’où la nécessité pour eux de suivre l’enseignement et les conseils des aînés. Cette éducation passe aussi par la prise de conscience, par les jeunes, d’un certain civisme. Chacun joue dans la société un rôle qui est fonction de ses capacités. D’où, le succès personnel doit être assimilé au succès de la société (influence du confucianisme).
En développant le judo, J. Kano souhaite associer trois éléments : éducation physique, combat et éducation de l’esprit. En 1918, il précise que le pratiquant doit saisir et réaliser trois étapes :
- L’étape inférieure, qui correspond à l’acquisition des méthodes d’attaque et de défense par le judo.
- L’étape intermédiaire, est celle de l’acquisition par le travail, l’entraînement d’un corps robuste et d’un esprit sain.
- La troisième étape est la transposition des deux premières au niveau beaucoup plus large, il s’agit de s’ouvrir à la vie, à la société. Le judo doit permettre de s’adapter à la vie en général. L’utilisation la plus efficace du corps et de l’esprit de travail, la vie familiale, la société, correspond à cette troisième étape. C’est le but ultime du judo, de se réaliser soi-même et de contribuer au monde. Le judo devient une « école de vie ».
Kano différenciait le judo du jujutsu par le fait qu’en judo, l’étude de la Voie est plus importante que la technique, la voie correspondant à l’étude des aspects moraux du judo (éducation de l’esprit). Très concrètement, Kano structura la pratique du judo en quatre méthodes : le randori, le kata, le cours et le mondo (questions réponses entre professeur et élèves). Un ensemble d’éléments sur l’esprit de la construction des katas (nouveaux katas construits entre 1884-1887 ; forme définitive en 1906) et sur le randori sont fournis dans cet ouvrage (à partir de la page 125).
Il est intéressant de souligner que l’apprentissage par la kata permet l’acquisition des connaissances par la répétition, et la répétition permet la création, c’est-à-dire sa propre connaissance. Trois étapes sont identifiées dans l’apprentissage des katas : SHU (gestuelle, reproduction du modèle), HA (étude physique et cognitive) et le RI (fluidité, imprégnation de l’essentiel). Le kata est un procédé d’apprentissage par le corps tout en permettant l’accès à une certaine spiritualité. Le kata dépasse de loin l’idée de modèle, l’assimilation doit se faire par le corps mais avec l’esprit. C’est par le kata que le pratiquant progresse et améliore sa technique afin de l’utiliser dans le randori et dans le shiai.
Kano était à la recherche d’une éducation physique idéale. Il identifia une méthode en 5 points (voir page 223) :
- Développer le corps de manière harmonieuse et équilibrée tant sur le plan des muscles que sur celui du cœur, sans risque autant que possible.
- Les mouvements ont chacun un sens, par conséquent ils doivent être accompagnés d’une maîtrise, qui doit aussi servir dans la vie.
- Elle est possible seule ou en groupe, praticable sans distinction entre jeunes et vieux, hommes et femmes.
- Elle ne nécessite pas un grand espace, peut être pratiquée avec une installation simple et dans une tenue de tous les jours.
- Elle est praticable dans le temps que vous vous êtes fixé, n’importe quand et de manière fractionnée, et il doit être possible de la pratiquer librement selon les circonstances ainsi que selon les facilités de chacun.
Kano (p. 288) précise que, le principe de l’efficacité maximum quand on l’applique en vue de donner la clé de la vie sociale ou de la perfectionner, aussi bien que quand on l’applique à la coordination de l’esprit et du corps (dans le sens de l’attaque et de la défense) demande, en premier lieu, l’ordre et l’harmonie parmi les membres, et cela ne peut être obtenu que par l’aide mutuelle et par les concessions qui conduisent à un bien-être et à des bénéfices réciproques. Le but final de judo est d’inculquer à l’homme une attitude de respect pour le principe de l’efficacité maxima, et du bien-être et de la prospérité mutuels et de le conduire à observer ces principes.
Cet ouvrage est intéressant. Il fournit un ensemble d’informations et de traductions de textes de Kano. Mais le message est clair : l’acquisition des connaissances et la compréhension des principes du judo passent d’abord par le travail du corps, par la pratique.
Jean-Marc DOUGUET, Août 2007